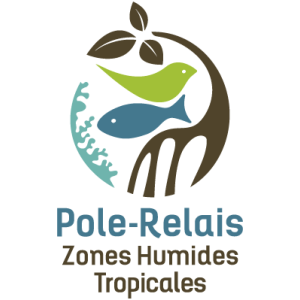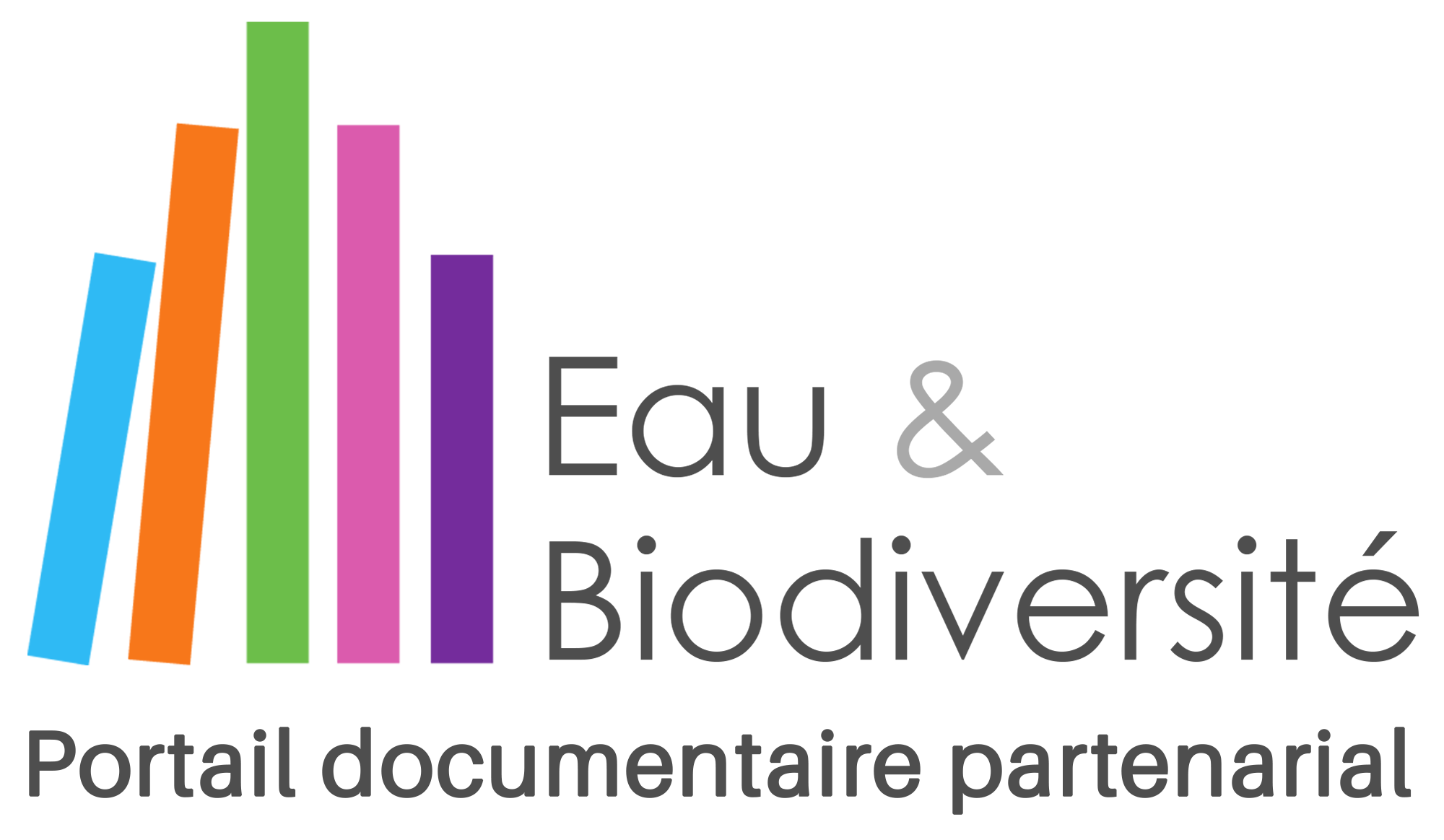
Document généré le 18/02/2026 depuis l'adresse: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/fr/notice/developpement-d-indicateurs-benthiques-dce-benthos-recifal-et-herbiers-de-phanerogames-dans-les-dom-analyse-des-mutualisations-possibles-entre-le-reseau-dce-et-les-autres-reseaux-de-suivi-des-recifs-coralliens-et-des-herbiers-dans-les-dom-version-finale
Développement d'indicateurs benthiques DCE (benthos récifal et herbiers de phanérogames) dans les DOM. Analyse des mutualisations possibles entre le réseau DCE et les autres réseaux de suivi des récifs coralliens et des herbiers dans les DOM. Version finale
Titre alternatif
Producteur
Contributeur(s)
Éditeur(s)
Identifiant documentaire
5-DOC00083205
Identifiant OAI
oai:ofb-oai.fr:DOC00083205
Auteur(s):
LE MOAL M.,AISH A.,MNHN,MNHN SPN
Mots clés
RECIF CORALLIEN
EAUX LITTORALES DES DOM
DOM
LA REUNION
ANGIOSPERME
PHANEROGAME
DCE
Date de publication
01/01/2013
Date de création
Date de modification
Date d'acceptation du document
Date de dépôt légal
Langue
fre
Thème
Type de ressource
Document
Source
43p.
Droits de réutilisation
Accès libre
Région
Guadeloupe,Martinique,La Réunion,Mayotte
Département
Commune
Description
La Directive Cadre Eau (DCE) requiert la mise en place de stratégies de surveillance ainsi que le développement d'indicateurs biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques permettant d'évaluer l'état écologique des masses d'eau continentales et littorales. Dans les départements d'Outremer insulaires (Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte), les récifs coralliens et les herbiers de phanérogames marines ont été retenus comme des indicateurs biologiques pertinents pour évaluer l'état écologique des masses d'eaux côtières. Ce rapport se focalise sur les réseaux de suivis des récifs coralliens et des herbiers mis en place dans les DOM insulaires et sur l'analyse des mutualisations possibles entre les réseaux DCE, les réseaux patrimoniaux (aires marines protégées : parcs, réserves) et l'Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR). Un état des lieux des réseaux a été réalisé, en partant des réseaux internationaux jusqu'aux réseaux locaux, suivi d'une analyse des passerelles possibles à établir. Au niveau national, l'IFRECOR a spécifiquement mis en place un Thème d'Intérêt Transversal dédié aux Réseaux d'Observation des récifs coralliens et des écosystèmes associés (TIT ResObs). Le volet Herbier de ce TIT a pour objectif d'intégrer de manière cohérente et harmonisée l'ensemble des suivis et actions menés sur les herbiers d'Outre-mer, notamment en identifiant une base commune de descripteurs et de protocoles standardisés. Les suivis DCE sont bien intégrés dans cette démarche, et ils représentent à l'heure actuelle 75% du ResObs Herbier en termes de nombre de stations. L'objectif est donc d'entretenir la cohérence de cette démarche. Pour le volet Récif, les liens entre la DCE et l'IFRECOR sont moins clairement établis. L'objectif du ResObs Récif est de consolider et développer les réseaux de suivis ReefCheck et GCRMN. ReefCheck est un programme de sciences participatives et les suivis sont réalisés par des bénévoles, en suivant une méthodologie simple. Les suivis GCRMN impliquent quant à eux la participation de scientifiques dotés de niveaux de compétences élevées en plongée et en taxonomie, et les méthodologies employées sont en ce sens relativement similaires avec celles utilisées dans le cadre de la DCE. Ainsi, d'un point de vue technique, une mutualisation des suivis DCE et GCRMN serait possible. Cependant, d'un point de vue spatial, la mutualisation de ces deux réseaux n'est pas possible dans tous les DOM. Au niveau local, chaque DOM présente en effet des spécificités historiques, techniques et biologiques, qui expliquent que le nombre et le type de suivis des récifs coralliens et des herbiers diffèrent, de même que l'état d'avancement de la mise en oeuvre des réseaux. En Martinique, les herbiers ne sont suivis que dans le cadre de la DCE. En revanche, sur les 15 stations DCE de suivi des récifs, 3 sont communes au réseau GCRMN. Bien que les protocoles et les acteurs impliqués dans ces suivis diffèrent beaucoup, les maîtres d'ouvrage sont favorables à des discussions sur le sujet d'une mutualisation. En Guadeloupe, sur les 35 stations DCE, 4 sont communes avec le réseau Réserve (2 stations herbier et 2 stations récif). Les protocoles utilisés sont pratiquement identiques. A la Réunion, les herbiers ne font actuellement l'objet d'aucun suivi du fait de leur petite superficie. Les suivis DCE des récifs doivent débuter en 2014, et ils devraient être mutualisés avec les suivis GCRMN pour les sept stations communes aux deux réseaux. Les maîtres d'ouvrage envisagent d'utiliser des protocoles harmonisés pour la mesure des nombreux paramètres communs aux deux types de suivi, quand quelques paramètres seront mesurés spécifiquement pour répondre aux questions DCE ou GCRMN. A Mayotte, les réseaux de suivi des récifs et des herbiers vont être définis de manière simultanée pour la DCE et pour le Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM). Les différents acteurs impliqués dans la définition de ces réseaux travaillent déjà en collaboration pour que le choix des stations, des paramètres et des protocoles se fasse de manière cohérente et harmonisée entre la DCE, le PNMM, et les réseaux type GCRMN déjà existants.
Accès aux documents
0
Consultations
0
Téléchargements