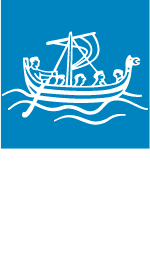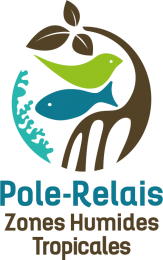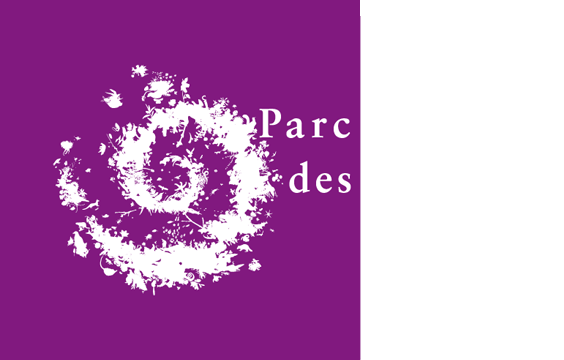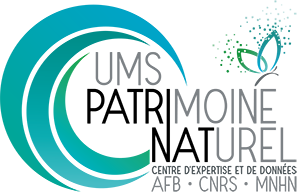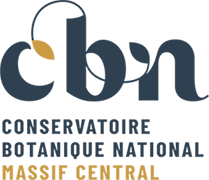- Recherche de documents
- Actualités
- Le Portail
- Ressources pour les contributeurs
- Espace perso
- Glossaire
- Thésaurus
Vous êtes ici :
L'anthracnose du pois. Revue bibliographique et synthese
Trois Sphaeropsidales apparentées (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes, Phoma medicaginis var pinodella) provoquent sur les divers organes du pois des macules nécrotiques et affectent le rendement et la qualité des récoltes. Le diagnostic des trois parasites par simple visualisation de symptômes reste aléatoire en raison de leur similitude pour les trois espèces et de la superposition fréquente de ces dernières sur la même plante-hôte. Cependant, l’observation au champ complétée d’une étude au laboratoire permet de proposer une clef de détermination. Des trois parasites, A pisi est l’espèce qui attaque le plus fréquemment les semences de pois. Cependant, compte tenu de l’agressivité de chaque champignon, Neergard (1979) considère comme économiquement acceptables des fréquences de contamination de la semence 4 fois plus élevées pour A pisi que pour M pinodes. La majorité des semences envahies par A pisi provient de gousses ne présentant pas de symptômes typiques. L’infection primaire de l’épicotyle n’est généralement pas décelable visuellement. Contrairement à M pinodes et P medicaginis, ce parasite ne produit ni microsclérotes, ni chlamydospores. Les chlamydospores de P medicaginis sont les mieux représentées dans le sol; leur agressivité vis-à-vis du système racinaire (footrot) augmente avec la répétition des cultures de la plante-hôte. Dix pour cent des infections primaires par M pinodes s’extériorisent entre la 4e et la 5e semaine de culture au niveau des écailles. Dans la majorité des cas, l’infection se manifeste à partir de la 6e semaine au niveau de l’épicotyle. À un faible taux de contamination des semences est associée une agressivité élevée vis-à-vis des entre nœuds de la plantule. La propagation liée à l’existence de plusieurs générations de pycnospores n’étant assurée que par les éclaboussements consécutifs aux pluies, elle reste de faible portée. Néanmoins, les ascospores transportées par voie aérienne confèrent à la phase sexuée homothallique de M pinodes des potentialités accrues de transmission et de dissémination secondaire. Heath et Wood (1969) décrivent la nécrogenèse chez M pinodes. Les macules limitées (nécroses brunes à croissance très lente et à parois cellulaires épaissies) sont presque stériles. En revanche, les lésions évolutives, plus claires, à croissance active, et parois cellulaires dégradées, portent de nombreuses pycnides. La fréquence des lésions évolutives augmente avec la quantité d’inoculum déposée, l’âge et la turgescence des organes. Pour ces auteurs, la résistance des parois à la macération ne serait pas la cause principale de l’arrêt du développement des macules limitées. Aussi celle-ci ne doit-elle pas être recherchée dans l’inhibition des enzymes de macération par les polyphénols, mais plutôt dans la synthèse de novo d’un ou plusieurs inhibiteurs de la croissance fongique. Les conditions de développement des lésions évolutives sont, quant à elles, en rapport avec la capacité de M pinodes à inactiver par voie enzymatique (déméthylation adaptative) une phytoalexine du pois, la pisatine. La variabilité de la virulence chez A pisi et M pinodes a été décrite pour deux ensembles distincts de lignées de pois. Deux lignées caractérisées par une bonne résistance de l’épicotyle à un échantillonnage d’isolats et de pathotypes de M pinodes, pourraient constituer des sources de résistance utilisables dans un programme d’amélioration. La résistance à A pisi est recherchée par l’utilisation d’une lignée sélectionnée vis-à-vis des pathotypes les plus répandus en Europe. Toutefois, une telle démarche ne garantit pas une résistance vis-à-vis de la totalité des pathotypes européens. Actuellement, la protection contre ces maladies fait surtout appel au traitement des semences. Toutefois la stratégie de lutte repose sur la création de cultivars de pois résistants et la production de semences saines., Three related Sphaeropsidales (Ascochyta pisi, Ascochyta pinodes (teleomorph Mycosphaerella pinodes, Phoma medicaginis var pinodella) induce spot-like necrosis on pea organs and cause yield and seed quality losses. Diagnosis of the 3 agents based on symptoms remains partly speculative: symptoms are fairly similar in the 3 species and may be mixed on the same host plant. However, a diagnostic key is provided by field observation associated with laboratory investigation. Among the 3 seed-borne pathogens, A pisi is the most frequently observed in the seeds. Nevertheless, because of the agressiveness of each fungus, Neegard (1979) estimates that the acceptable disease tolerance level for A pisi is 4-fold that for M pinodes. The majority of seeds contaminated by A pisi are attacked without typical symptoms on pods. Primary epicotyl infections are not generally visually detectable. In contrast with M pinodes and P medicaginis, A pisi produces neither microsclerotia nor chlamydospores. The chlamydospores of P medicaginis are most frequently isolated from the soil; their agressiveness towards roots (footrot) increases with continuous pea cropping. Ten percent of primary M pinodes infections appear during the 4th and 5th week on embryonary bracts. The bulk of infections are observed on the epicotyl after the 6th week. Weak contamination is able to provoke a high level of agressivity towards the plumule. Dispersal of several generations of pycnospores in the field occurs only through rainfall (splashing) and remains limited. Nevertheless, wind-borne ascospores provided from the homothallic phase of M pinodes provide higher potentialities for transmission and secondary spread of the disease. Heath and Wood (1969) showed the formation of leafspots induced by M pinodes. They discriminated limited necroses from spreading lesions. Limited necroses are brown, have a slow growth rate and thickened cell walls. They are almost sterile. Spreading lesions are light green with degraded walls and bear numerous pycnidia. Their frequency increases with inoculum concentration, spore deposit, ageing and turgidity of organs. According to these authors, the major factor in hindering the development of limited lesions is not the resistance of plant cell wall to maceration. This suggests the role of de novo biosynthesis of one (or more) growth inhibitor(s) rather than the inhibition of macerating enzymes by polyphenols. The development of spreading lesions is associated with M pinodes’ ability to inactivate the phytoalexin in pea (pisatin) by enzymes (inducible demethylation). The variability in virulence of A pisi and M pinodes has been recently described for 2 separate sets of pea lines. Two strains, showing a good resistance of the epicotyl to isolates and pathotypes of M pinodes, may become useful sources of resistance. A pisi resistance exists in a line selected towards the more frequently isolated pathotypes in Europe. Nevertheless, this resistance does not ensure incompatibility towards all European pathotypes. Currently, the methods of control consist of fungicide treatment of seeds. A long-term strategy for Ascochyta disease must be based on the breeding for resistant cultivars and the production of disease-free seeds.
Auteurs du document :
Allard, C., Bill, L., Touraud, G.Mots clés :
Sciences agricoles, Agricultural sciences, RESISTANCE, pisum sativum, pois, mycosphaerella pinodes, ascochyta pisi, phoma medicaginis, diagnostic, cycle biologique, symptomatologie, pathotype, phytoalexineThème (issu du Text Mining) :
AGRICULTUREDate :
1993Format :
text/xmlSource :
Agronomie 1 (13), 5-24. (1993)Langue :
InconnuDroits d'utilisation :
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Télécharger les documents :
Un permalien est l'URL initiale d'un article ou d'une page, conçu pour refèrer un élément d'information et rester inchangé de façon permanente.Permalien :
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/l-anthracnose-du-pois-revue-bibliographique-et-synthese0