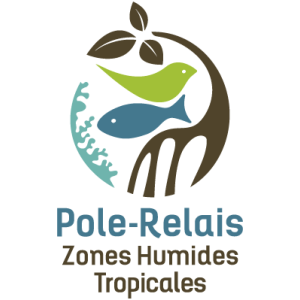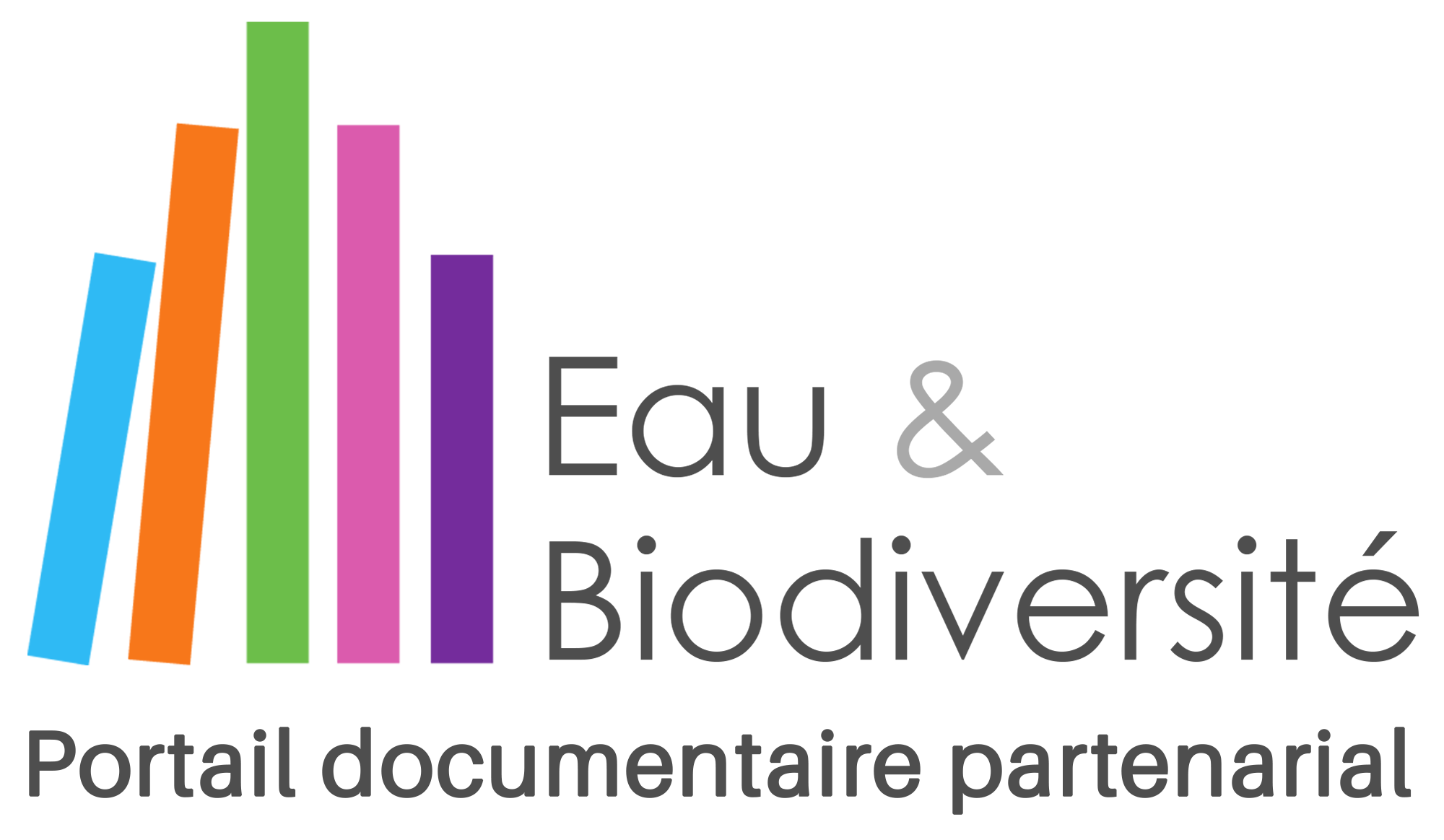
Document généré le 31/08/2025 depuis l'adresse: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/fr/notice/bilan-des-introductions-recentes-d-amphibiens-et-de-reptiles-dans-les-milieux-aquatiques-continentaux-de-france-metropolitaine
Bilan des introductions récentes d'amphibiens et de reptiles dans les milieux aquatiques continentaux de France métropolitaine
Titre alternatif
Producteur
Contributeur(s)
EDP Sciences
Identifiant documentaire
11-1997018
Identifiant OAI
oai:edpsciences.org:dkey/10.1051/kmae:1997018
Auteur(s):
P. HAFFNER
Mots clés
Date de publication
01/08/2008
Date de création
Date de modification
Date d'acceptation du document
Date de dépôt légal
Langue
fr
Thème
Type de ressource
Source
https://doi.org/10.1051/kmae:1997018
Droits de réutilisation
Région
Département
Commune
Description
En France métropolitaine, on dénombre actuellement 36 amphibiens et 33 reptiles se reproduisant régulièrement. A deux exceptions près, les amphibiens de la faune française sont aquatiques. En revanche, seules quatre espèces de reptiles (2 tortues et 2 serpents) fréquentent très régulièrement ou exclusivement les milieux aquatiques. Les introductions en milieux aquatiques effectuées depuis le début du siècle ne concernent qu'une vingtaine d'espèces d'amphibiens ou de reptiles. Le discoglosse peint (Discoglossus pictus) et la grenouille taureau (Rana catesbeiana) sont les deux seules espèces étrangères dont l'introduction a conduit à une naturalisation. La tortue de «Floride» (Trachemys scripta elegans) pourrait bien suivre prochainement la même voie. Certaines espèces françaises ont, par contre, été introduites avec succès en métropole, hors de leurs aires d'indigénat. Les causes connues de ces introductions sont liées à des opérations à but économique (commerce), à caractère socioculturel (loisirs) ou à fondement scientifique (expériences). Ces opérations n'ont cependant généralement pas pour but l'introduction volontaire d'une espèce dans le milieu naturel, celle-ci résultant plutôt de négligences. Certaines introductions involontaires ont pu aussi avoir pour origine un transport passif (par exemple, par voie maritime). Des conséquences négatives de ces introductions sont suspectées, mais ne sont généralement pas démontrées. Elles peuvent s'inscrire dans les catégories suivantes : compétition avec une espèce autochtone, prédation excessive sur une ou plusieurs espèces autochtones, pollution génétique, introduction de maladies ou de parasites.
Accès aux documents
0
Consultations
0
Téléchargements