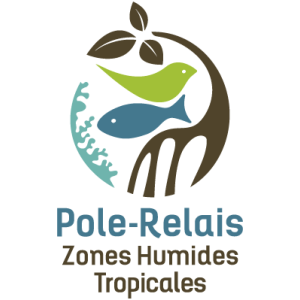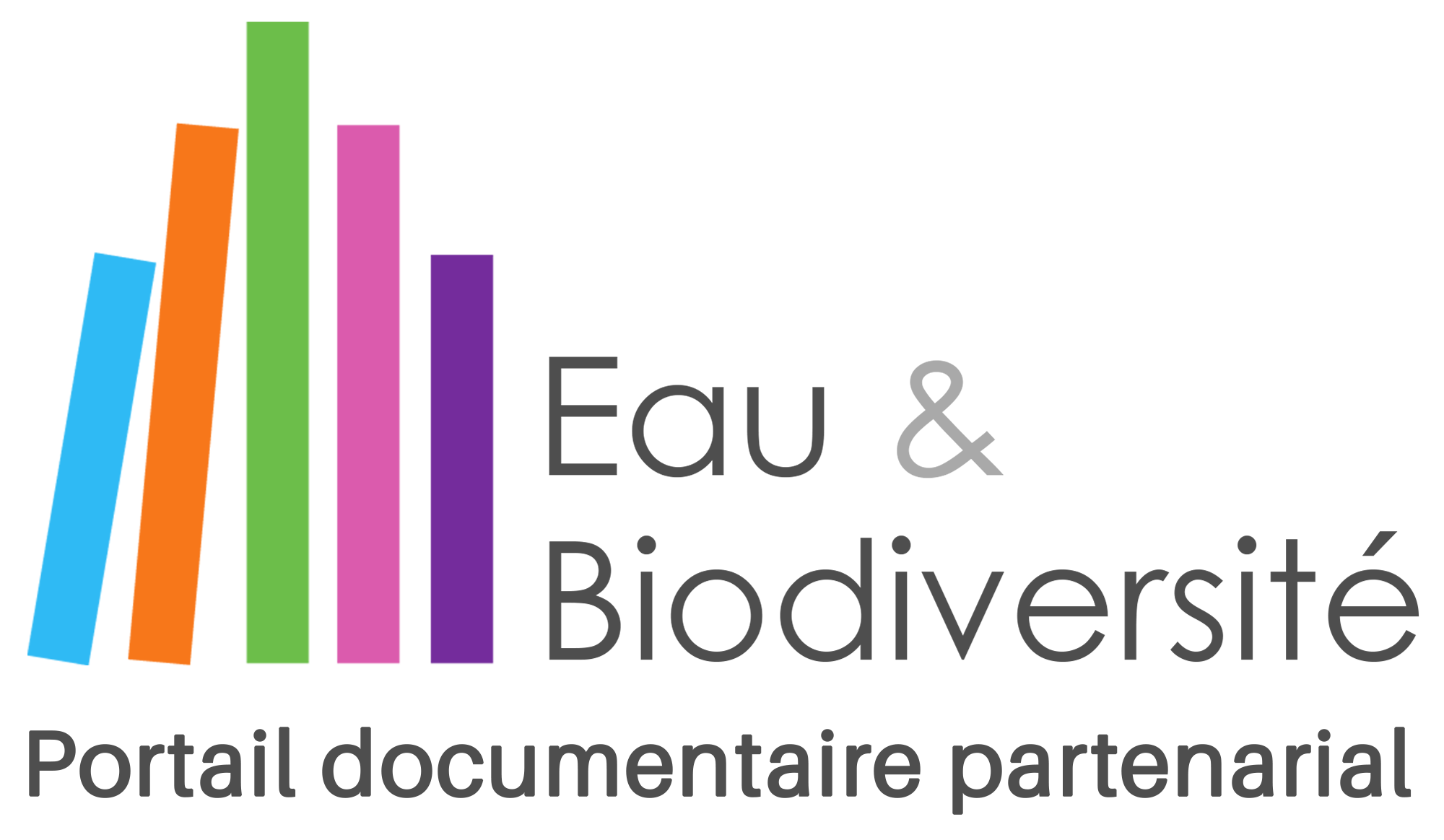
Document généré le 18/02/2026 depuis l'adresse: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/fr/notice/synthese-recommandations-application-d-outils-biologiques-pour-la-recherche-et-la-caracterisation-des-effets-des-micropolluants-des-eaux-usees-de-la-collecte-des-eaux-usees-au-milieu-recepteur-livrable-04
Synthèse & Recommandations. Application d'outils biologiques pour la recherche et la caractérisation des effets des micropolluants des eaux usées. De la collecte des eaux usées... au milieu récepteur. Livrable 04
Titre alternatif
Producteur
Contributeur(s)
Éditeur(s)
Identifiant documentaire
5-DOC00083796
Identifiant OAI
oai:ofb-oai.fr:DOC00083796
Auteur(s):
PENRU Y.,SUEZ,INERIS,TOXEM,IRSTEA,BIOMAE,EPOC,SYNDICAT DES BOUILLIDES,AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE,AFB,PERCEVAL O.
Mots clés
TOXICITE
VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS
MICROPOLLUANTS
BIOESSAIS
RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES
STEU
EDA
Date de publication
01/01/2018
Date de création
Date de modification
Date d'acceptation du document
Date de dépôt légal
Langue
fre
Thème
Type de ressource
Document
Source
25p.
Droits de réutilisation
Accès libre
Région
Département
Commune
Valbonne
Description
Le projet MICROPOLIS Indicateurs propose et développe une stratégie innovante pour la détection, la caractérisation et l'identification des micropolluants des eaux usées urbaines et de leurs impacts avérés et/ou potentiels. Dans ce but, un des principaux objectifs du projet est d'évaluer et de valider un ensemble cohérent d'outils biologiques pour : -la recherche et l'identification des micropolluants pour leur réduction à la source, i.e. avant traitement à la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) ; -l'évaluation des performances d'élimination ou de réduction de la toxicité des micropolluants par les procédés de traitement de la STEU des Bouillides, en particulier l'ozonation ; -la caractérisation de l'empreinte chimique du rejet de la STEU des Bouillides et son impact toxique potentiel dans le milieu récepteur. Cette batterie d'outils biologiques est constituée de plusieurs bioessais (in vitro et in vivo) de laboratoire et de terrain ainsi que de méthodes de bio-surveillance, qui ciblent différents modes d'action des contaminants et différentes fonctions physiologiques des organismes. Ces outils ont été appliqués sur l'ensemble du système d'assainissement du territoire de Sophia-Antipolis (Syndicat des Bouillides) du réseau de collecte des eaux usées jusqu'au rejet de la STEU et dans le milieu récepteur afin de répondre à différents enjeux de la lutte contre les micropolluants aquatiques. La complémentarité des bioessais appliqués dans le cadre de cette étude a permis de caractériser le profil de toxicité des eaux depuis différentes branches du réseau de collecte des eaux usées jusqu'au rejet de la STEU. Sur l'ensemble du réseau, cette caractérisation indique que les profils d'activité peuvent varier d'un point à un autre du réseau révélant la présence de différents micropolluants (ou à des niveaux de concentration différents) suivant les branches. Cette caractérisation a permis également de mettre en évidence une réduction de la toxicité des eaux usées tout au long du traitement même si la présence d'activités génotoxique et perturbateurs endocriniens résiduelles est observable après traitement. Les effluents de la STEU des Bouillides présentent un profil de d'activité biologique et d'effet assez atypique, notamment pour certaines activités PE. Les niveaux d'activités oestrogéniques et androgéniques, caractéristiques des eaux usées, sont particulièrement élevés comparés aux valeurs de la littérature. Il n'existe pas (ou très peu) de référence dans la littérature pour évaluer les niveaux d'activités pour les autres bioessais. Toutefois, il est à noter que l'activité GR, quantifiée en différents point du réseau et en entrée de STEU, est considérée comme spécifique des eaux usées d'origines industrielle et/ou hospitalière. Ces observations sont cohérentes avec les différentes origines (urbaines, industrielles, hospitalières) des eaux usées transitant par la STEU. Les analyses non-ciblées effectuées sur les fractions ayant les activités les plus importantes ont permis de suspecter, parmi les centaines de signaux détectés, plusieurs composés en entrée de la STEU et dans le réseau d'eaux usées. Parmi les composés ayant été confirmés, sont identifiés des produits de transformation comme l'oxindole, le O-desméthylvenlafaxine, des composés naturels comme la daidzéine, la pipérine et des molécules de synthèse comme l'éthylparabène et le climbazole. Dans la liste de molécules identifiées, la daidzéine et l'éthylparabène sont des ligands connus du récepteur des oestrogènes et leur présence contribue à l'activité oestrogénique. Les autres molécules citées ont été testées pour les bioessais mais n'ont pas présenté d'activité notable, suggérant qu'elles ne contribuaient pas à l'activité détectée dans les fractions analysées. D'autres molécules, non identifiées par la méthode d'analyse utilisée, sont manifestement contributrices mais n'ont pu être identifiées à ce stade. Dans une perspective de suivi des impacts sur le milieu récepteur, il semble nécessaire de recourir à différents organismes représentatifs de différents groupes taxonomiques (invertébrés, poissons) ou niveaux trophiques, du fait de leur diverses sensibilités aux contaminants (notamment en fonction du mode d'action de ces derniers). Cette étude montre clairement que les traitements complémentaires améliorent la qualité de l'effluent, en diminuant la toxicité liée à la présence de contaminants chimiques et donc leur apport dans les milieux aquatiques. Dans le cas de la Bouillide, nos travaux montrent cependant que l'effluent sortant constitue encore un apport de toxicité dans le milieu récepteur, comme démontré par les effets mesurés sur les taux d'alimentation et la fécondité du gammare. Cet apport de contaminants toxiques et de toxicité, également confirmé par les approches in-situ chez le gammare et l'utilisation du poisson, montre l'intérêt de ces approches pour évaluer l'impact d'un rejet sur le milieu.
Accès aux documents
0
Consultations
0
Téléchargements